Le matériel d’océanographie
Les océanographes ont pour mission de recueillir un maximum d’informations sur les océans. Ils se penchent sur tous les aspects des mers (sans y tomber bien sûr !). L’océanographie étudie leurs
limites, leurs fonds, les côtes mais aussi la faune qui y vit. Les océanographes vont être chargés de mesurer, mettre en évidence des paramètres physiques, vérifier des théories et faire des observations sur le terrain (on dit « in-situ »). Pour ce faire, ils ne peuvent pas aller bien loin avec des palmes, un tuba et un double décimètre.
Pour les aider dans leurs recherches in-situ, ils se servent des connaissances issues d’autres disciplines scientifiques :
• Dynamique des fluides (courants, marées…)
• Chimie de l’eau de mer,
• Géologie des fonds marins
• Biologie et microbiologie marines
• Chimie et biochimie
• Géologie
• Sismologie
• Hydrologie
• Météorologie
• …
Les océanographes disposent aussi de différents outils et matériels qui ont beaucoup évolué depuis la naissance de cette science.
Les navires
Pour étudier la mer, il faut aller en mer ! Il semble donc évident que les bateaux représentent un équipement de base pour les études océanographiques en milieu maritime. En fonction du lieu à étudier, les océanographes n’utiliseront pas le même type de navire
- Pour les campagnes en pleine mer : les navires hauturiers.
- Pour les campagnes le long des côtes : les navires côtiers.
Parfois aussi, certains navires militaires sont utilisés pour la recherche océanographique.
Qu’ils s’agissent de navires civils ou militaires, tous sont équipés de matériel et d’appareils qui prendront des mesures et réaliseront des relevés précis pour le compte des océanographes.
Les instruments de mesure
1/Pour mesurer la profondeur et connaître le relief des fonds marins
 Au commencement de l’océanographie, on se servait d’un plomb de sonde et d’un fil. Ensuite, on fit appel à des instruments utilisant les sons (vers 1919), puis les ultrasons (après 1920).
Au commencement de l’océanographie, on se servait d’un plomb de sonde et d’un fil. Ensuite, on fit appel à des instruments utilisant les sons (vers 1919), puis les ultrasons (après 1920).
Les équipements acoustiques utilisés aujourd’hui sont de très haute-technologie :
➢ Sondeurs de bathymétrie et de pêche
➢ Sonars actif
Ces outils émettent des impulsions sonores dans l’eau de mer. Quand les ondes atteignent un obstacle, elles rebondissent comme des balles vers la surface. L’antenne réceptrice, composée de « micros sous-marins » (hydrophones) capte alors les « échos ». Puis vient le moment de faire un petit calcul qui ressemble aux problèmes mathématiques donnés à l’école !
➢ Puisque l’on connait la vitesse de propagation du son dans l’eau salée (en moyenne 1500 m/s).
➢ On peut connaitre la distance à laquelle est l’obstacle en se servant du temps mis par l’onde pour faire l’aller-retour.
Les échos, appelés « images acoustiques » sont ensuite traduits en image vidéo, visualisées sur un écran au poste de commande.
Zoom sur les sonars
➢ Le mot SONAR vient de l’acronyme anglais « Sound Navigation And
Ranging ».
➢ L’appareil utilise les propriétés de la propagation du son dans l’eau.
➢ Grâce à elles, il est capable de détecter et situer les objets sous l’eau.
➢ Il indique leur direction et distance.
➢ Les obstacles, objets ou reliefs se traduisent sur les relevés par des ombres dont la forme correspond à l’objet, l’obstacle ou le relief observé.
➢ Le SONAR est utile aussi bien pour la détection des mines et des épaves que pour l’étude du relief des fonds marins.
➢ Il s’agit en général d’appareillages légers, aisés à transporter pour l’utilisation sur des petits fonds. Mais il existe aussi des modèles possédant une grande portée, conçus pour l’étude des grands fonds.
Suite de notre présentation des outils des océanographes, la semaine prochaine ! En attendant, je m’en vais chasser la seiche et sa cape d’invisibilité.
Crédits photos : Par Ph. Saget — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50254579
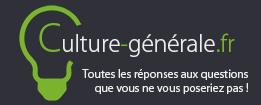

Pas de commentaire actuellement.
Ajouter votre commentaire